Chaque soir, nous sommes des centaines de millions, dans le monde entier, devant nos téléviseurs, à suivre le décompte macabre des morts avant d’aller applaudir les nouveaux héros des temps modernes que sont les soignants. Ce temps d’épidémie et de confinement nous interroge sur notre rapport à la mort et au courage.
Cela m’a remis à l’esprit un livre du théologien protestant Paul Tillich, paru dans les années 50 : « Le courage d’être ». Tillich distingue deux formes de courage complémentaires : le courage d’être soi-même et celui d’être en participant, le courage d’assumer et d’affirmer sa propre singularité, puis celui de se situer dans le monde, en collaboration avec les autres. Pour Tillich ce double-courage est la réponse à trois formes d’angoisse qui caractérisent la condition humaine devant la menace du non-être : l’angoisse face au destin et à la mort, l’angoisse de la culpabilité, l’angoisse face au non-sens.
L’angoisse face au destin et à la mort témoigne du paradoxe infligé à notre conscience humaine : nous vivons et un jour nous ne serons plus ; en attendant nous ne savons pas ce qui peut survenir demain. Cette angoisse exprime un refus viscéral de se résigner à l’inéluctable ; elle génère soit un processus dépressif, soit une créativité défensive. Dans des sociétés précaires cela donne par exemple des traditions transmises de générations en générations avec des rituels à forte portée protectrice ; dans des sociétés très sécurisées comme la nôtre, cela se traduit par le crédit accordé à la science, à la médecine, au principe de précaution, mais aussi par l’occultation maximale de la mort, et le déni de l’angoisse qu’elle génère. Mais aujourd’hui, au cœur de cette épidémie et de ce confinement ; qu’en est-il ? L’angoisse du destin et de la mort fait- elle son retour ? Ou bien parvenons-nous à l’apprivoiser sous la litanie des chiffres morbides égrenés chaque jour, et la difficulté, qui va parfois jusqu’à l’impossibilité, d’enterrer nos morts selon les rites habituels ? Dans ce contexte les courageux soignants que nous applaudissons quotidiennement jouent peut-être un double rôle, de catharsis et d’identification. En affrontant et « maîtrisant » le virus et la mort ils prennent nos peurs sur eux et nous en libèrent. De plus ils nous donnent un très beau modèle du double – courage : de la vocation personnelle et de la mission collégiale. On peut imaginer qu’au sortir de cette aventure, nombre de collégiens et lycéens exprimeront le désir de s’engager dans des études et des métiers de soignants.
Quant à l’angoisse de la culpabilité, qu’on a souvent attribuée à la morale judéo-chrétienne, elle est liée à notre faculté de jugement éthique. Devant Dieu nous sommes pécheurs, ce qui ne se caractérise pas par le nombre et la qualification de nos fautes, mais par la conscience de notre imperfection fondamentale, cette « in-fiabilité » douloureuse qui fait que, au-delà de nos actes volontaires, il y a ce bien que nous voudrions faire et que nous ne faisons pas et ce mal que nous ne voulons pas faire et que nous faisons. Il y a ce ratage, ce paradoxe propre à la nature humaine, dont nous serions inconsolables sans notre faculté de déni et d’oubli, ou bien sans la confiance que nous avons en la grâce de Dieu et/ou en l’amour de ceux qui nous chérissent. Vivons-nous, et comment, cette angoisse de la culpabilité en ce temps d’épidémie et de confinement ? Nous sentons-nous coupables de la venue et de la diffusion de ce virus ? Et le sommes-nous réellement ? On entend ici et là des mea-culpa sur notre mode de vie, sur les effets de la déforestation, les déséquilibres climatiques que nous provoquons au niveau de la planète et dont l’apparition de nouveaux virus serait une des manifestations. Sont régulièrement dénoncés les manques et les insuffisances de ceux qui nous gouvernent dans la lutte contre le virus. On voit aussi circuler de folles rumeurs sur internet, fleurir des théories du complot. S’il y a un mal, c’est qu’il y a un coupable. Le mécanisme à l’œuvre est celui de la théologie de la rétribution. Mais quand la culpabilité vise les autres ou se dilue dans l’anonymat, elle n’a aucune chance de se transformer en responsabilité. Heureusement la crise est aussi l’occasion d’actes d’entraide, d’engagements nouveaux et d’initiatives courageuses de la part de personnes très diverses, qui, pour certaines, ont le sentiment de réhumaniser le monde et de préparer un changement profitable à tous.
Car la grande question de cette épidémie et de ce confinement qui a paralysé le monde entier est celle de l’avenir. Quand on se prend à rêver on s’assure qu’il sera meilleur évidemment que le monde d’avant. Mais dans le réel on se prend à espérer simplement le retour à ce monde d’hier qui, bon an mal an, fonctionnait, et qui en tout cas était le nôtre, celui que nous connaissions. Entre les deux sourd une angoisse face aux non-sens de notre condition présente. Comment assumer que notre monde si puissant à tous les niveaux se soit retrouvé paralysé par un minuscule petit virus dont les effets mortels n’ont, pour l’instant et heureusement, rien à voir avec ceux de la peste noire ou de la grippe espagnole ? Comment accepter que pour protéger la vie de nos anciens on les ait exposés à périr de solitude et d’ennui ? Comment conjuguer de manière réaliste les nécessités écologiques de la planète et les besoins socio-économiques des populations en termes de moyens de subsistance ? Sans doute faudrait-il moins d’avions dans le ciel, mais environ 25 millions de personnes dans le monde vivent du transport aérien. Et beaucoup de pays ont un besoin crucial de la manne touristique. Comment renoncer aux « évidences », bonnes ou mauvaises, qui balisaient notre existence, pour regarder en face les incertitudes, le flou, quand ce n’est pas le spectre de la catastrophe, qui nous séparent de la « reprise » ? Nous sommes comme dessaisis de ce dont nous étions des bénéficiaires souvent inconscients : l’assurance que confère une extraordinaire sécurité assortie d’une non moins extraordinaire liberté. Et d’une certaine manière cela nous permettait de nous distraire sans cesse de bon nombre de préoccupations ultimes et spirituelles, et de la condition si précaire d’un grand nombre de nos contemporains.
Mais si aujourd’hui nous sommes rattrapés par l’angoisse face à l’absurde, cela peut constituer une chance formidable de changer notre regard et d’exercer notre courage d’être. Car ce virus nous fait découvrir deux choses essentielles : l’humanité est vraiment une, au-delà des frontières et de toutes les différences socio-culturelles et économiques des sociétés ; et le choix quasi-généralisé du confinement a montré que nous étions capables, ensemble, de sacrifier pour un temps la marche économique du monde pour sauver des vies humaines. Aurons-nous le courage personnel et collectif de reconstruire, à partir de ces deux fondamentaux, un monde plus sensé, accueillant et généreux pour tous, et surtout pour la jeunesse et les générations à venir ?
Florence Taubmann


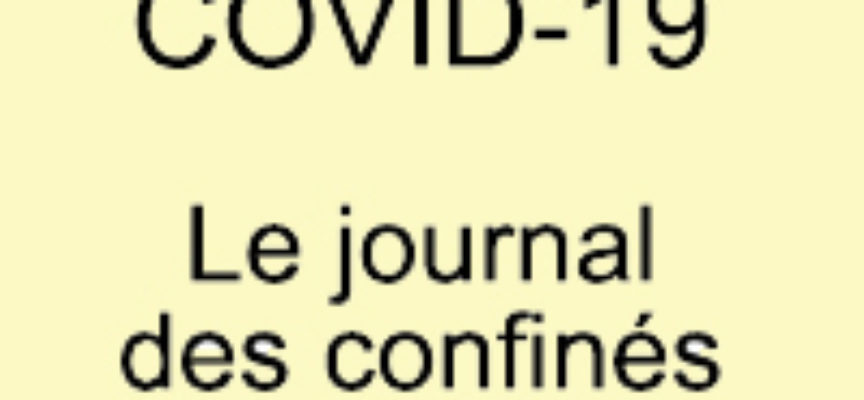





Aucun commentaire !
Soyez le premier à commenter cet article.