Me voici écrivant, à mon tour, « mon » journal d’un confiné. M’ont précédé des textes en parfait reflet de ce que nous sommes, chacun différent, plus ou moins idéalistes ou réalistes, plus ou moins atterrés par ce que vous vivons tous ensemble depuis plus d’un mois. Autant le dire tout de suite, ce que j’écrirai ici ne surprendra pas ceux qui me connaissent un peu : ingénieur pendant toute ma vie professionnelle, l’évaluation des risques me guide toujours ; et, passionné d’Histoire, j’en ai surtout retenu qu’au siècle dernier les constructions d’un « monde nouveau » se sont soldées par des dizaines de millions de morts.
Mais puisqu’il s’agit d’épidémie, parlons d’abord de « La Peste », l’œuvre d’Albert Camus dont notre président nous recommandait la lecture ou la relecture. Peu de gens le savent, mais cet immense écrivain né en Algérie retrouva sous l’Occupation son ami André Chouraqui, réfugié comme tant d’autres juifs au Chambon-sur-Lignon, où l’admirable solidarité de nos amis protestants sauva des milliers de vies. A l’époque, Camus pensait déjà au livre finalement publié en 1947, et que l’on a vu souvent comme une allégorie du nazisme. En 1942, donc, il écrivit des notes et il eut des discussions avec Chouraqui. Celui-ci lui parla du passage de la Bible où est évoquée une épidémie de peste, plus précisément dans le premier Livre de Samuel, chapitre 5. En résumé, les Philistins, vainqueurs des Hébreux, s’emparent de l’Arche d’Alliance et la placent dans le temple de leur « dieu », à Ashdod : mal leur en prend, ils retrouvent la statue de leur idole à terre, et ils sont frappés de tumeurs ; des stigmates de la terrible maladie, comme devait l’expliquer Chouraqui à son ami. Cet épisode est illustré par une toile de Nicolas Poussin, conservée au Musée du Louvre. Mais ce n’est pas tout : sur son blog, Maurice Ruben Hayoun rapporte un extrait de l’autobiographie du regretté co-fondateur de la Fraternité d’Abraham : « Lors d’une conversation entre eux, Camus demanda à André comment on dit la peste en hébreu. André répondit DEVER. Il ajouta que la même racine vocalisée autrement signifiait la parole, DAVAR. Et Camus de conclure : la peste survient lorsqu’on travestit le sens des mots. »
Première leçon, donc : faisons très attention à ce que nous disons ou écrivons, en ces moments de tension extrême, alors que plusieurs crises, sanitaires, puis économiques, puis sociales ont commencé et qu’on n’en voit pas l’issue. Reconnaissons ce qui tient du « wishfull thinking », entre vœu pieux et prendre ses désirs pour des réalités ; et méfions-nous de ce que nous vendent les populistes de tout bord : « bâtissons des murailles », « vivons en autarcie », « renversons le capitalisme », ce n’est pas dit exactement ainsi mais c’est une musique qu’une oreille un peu fine peut déjà entendre, même si les politiques ne sont pas pour le moment sur le devant de la scène, occupé par les médecins et infectiologues. Méfions-nous des marchands de rêves, qui prétendent que l’on règlera en même temps et sans durs sacrifices tous les défis – l’épidémie, mais aussi ce qui existait avant ; à commencer par la crise climatique, qui n’a rien à gagner à l’effondrement actuel du prix du pétrole.
Mais revenons au livre d’Albert Camus. Dans la ville d’Oran, brutalement frappée par l’épidémie, vont s’agiter ou lutter une galerie de personnages : des méchants et des pervers – à notre époque, il partageraient des théories du complot sur les réseaux sociaux ; un prêtre, le Père Paneloux, durement jugé alors que sa foi est mise au défi du malheur absurde ; ceux qui tentent d’oublier ; mais aussi trois héros, un journaliste, un médecin et un bénévole révoltés par ce qui arrive. Aucun d’eux ne croit à l’utopie d’un bonheur immuable. Et les lignes de la fin, froidement réalistes, le disent bien : « … Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparait jamais (…), et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une ville heureuse. »
La peste, on l’ignore en général en s’arrêtant à la fameuse « Peste noire » du milieu du 14ème siècle », a frappé à plusieurs reprises en Europe, même si le bilan des victimes fut heureusement plus limité. J’ai ainsi découvert – on vagabonde beaucoup sur Internet en ces temps de confinement – la terrible épidémie qui frappa la ville de Marseille et ses environs en 1720, faisant environ 100.000 morts en quelques mois. On peut ainsi revoir un excellent documentaire de la série « L’ombre d’un doute ». Et on apprend qu’existait à l’époque une procédure en théorie imparable de contrôle sanitaire, avec quarantaine obligée de tous les bateaux venant du Levant ; mais une série de défaillances, jointe à la cupidité de certains édiles marseillais, allait provoquer la catastrophe. Doit-on le souligner ? La cargaison maudite du « Grand-Saint-Antoine » renfermait des étoffes et soieries embarquées au Liban et pourtant il y avait si peu de commerce international ! Et pas de « mondialisation » avec une Chine « usine du monde » que personne n’imaginait à l’époque. Deux siècles plus tard, au moment de la pandémie de la « Grippe espagnole » qui fit des dizaines de millions de morts, notre univers économique ressemblait plus à celui de la peste de Marseille qu’à celui d’aujourd’hui, que certains voudraient détricoter de fond en comble.
Pour finir, je laisse la parole à un esprit brillant, Nicolas Tenzer, que j’ai eu déjà le plaisir de recevoir deux fois dans mon émission. Après une formation très prestigieuse et une carrière à la fois politique et académique, il a une vision à la fois éthique et « aérienne » du monde dans lequel nous vivons. Il a écrit un très long article intitulé « De la prudence aux temps du Coronavirus », riche de dizaines de références proposant des interprétations différentes de la crise que nous vivons. Et il nous invite à réfléchir, avec recul et méfiance par rapport aux régimes autoritaires qui veulent nous affaiblir.
« Le monde d’après le Covid-19 sera certainement plus vulnérable, parce qu’il sera, au moins pour quelque temps, affaibli économiquement et que ses gouvernements seront sujets à de nombreuses accusations, mais il ne sera pas fondamentalement nouveau. On ne saurait dire non plus si, en fin de compte, ses sociétés seront plus faibles ou au contraire plus fortes après l’épreuve. Cela sera aux dirigeants, leaders d’opinion, journalistes, savants, entreprises, de faire en sorte que ces sociétés et les personnes qui les composent soient à la fois plus résilientes et plus unies. (…) La deuxième règle consistera à ne pas alimenter ce discours de rupture, précisément parce qu’il profiterait à ceux qui entendent l’imposer. Non, le monde ne sera pas plus uni ; non, la coopération internationale ne sera pas plus facile ; non, les jeux d’influence, y compris au sein des organisations internationales, n’auront pas disparu, et l’on peut même soutenir que leur exacerbation est tout aussi possible, sinon plus. Le monde ne sera pas plus enclin à la paix et la coopération tout simplement parce qu’il y aura toujours des régimes qui ne le souhaiteront pas. »


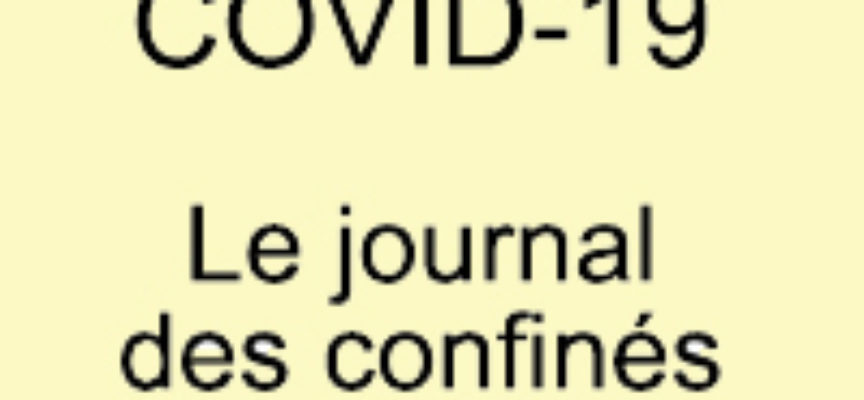
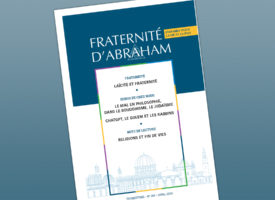


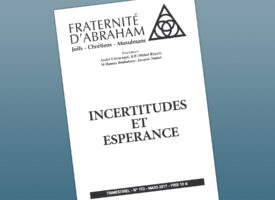

Merci Jean pour ce bel article
Pascal Roux