Le 11 mai 2015, Bernard Esambert publiait « Plaidoyer pour une éthique du libéralisme« . Dans le cadre des travaux de la Fondation Éthique et Économie qu’il a cofondé avec l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Bernard Esambert revient sur ce texte fondateur et poursuit le développement de sa pensée suite aux premières conférences qui se sont tenues à l’Institut.
L’espèce humaine ressemble furieusement à un véhicule en pleine accélération, conduit par d’innombrables pilotes vers un avenir incertain.
Tout a commencé dans les années 1960, quand le commerce mondial s’est mis à croître beaucoup plus rapidement que la richesse (le PNB) mondiale. Le progrès technique et un rythme effréné des moyens de transports, des produits et des informations ont accéléré le mouvement.
Aujourd’hui les échanges internationaux représentent plus du tiers du PNB mondial et nous travaillons tous deux jours sur trois pour l’exportation. Les exportations d’usines puis des laboratoires de recherches pour suivre et naturaliser les produits, donc les transferts de capitaux et leur accompagnement financier ont suivi.
Ainsi est née la mondialisation dont on nous rebat les oreilles. La libéralisation des marchés ainsi que la financiarisation de la sphère économique ont fait le reste, et nous vivons désormais dans un monde de marchands produisant massivement du confort matériel, des services et des images. Le contexte est celui d’un combat économique qui a transformé la planète en champ de bataille, sans morale ni spiritualité. Si sur le plan matériel, le libéralisme des temps modernes a apporté la satisfaction des besoins vitaux à des centaines de millions d’individus, il a creusé l’écart entre une société de consommation qui déborde de biens matériels et d’images pour les uns sans procurer un minimum vital décent pour les autres.
Sans doute la source de nos passions est-elle l’amour de soi. Mais elle se double d’une réciprocité, l’assujettissement à l’autre. On n’est jamais quitte à l’égard d’autrui car on se construit au contact de l’autre. L’homme seul ne peut survivre et c’est dans le contact avec ses semblables, avec le groupe, qu’il apprend les codes de la société : sortie de soi, solidarité, compassion. Tant il est vrai que pour prospérer depuis des centaines de milliers d’années le sapiens a eu besoin des autres pour survivre. La morale est peut-être d’abord génétique mais elle peut s’imposer aussi à nous sans notre consentement, sans qu’il nous soit possible de nous dérober. Je suis « malgré moi pour les autres ». Nulle magnanimité, c’est mon destin d’homme façonné par d’innombrables générations et par ma construction auprès des autres. Si je suis homo empathicus, c’est par nécessité.
Car même si la vie était appropriation et assujettissement des plus faibles, si rien n’était ni bon ni mauvais, si le plus efficace devenait sans limite le plus fort, la violence devrait malgré tout s’apprivoiser, faute de quoi son coût, dans une société composée de maîtres et d’esclaves, risquerait de devenir inacceptable
Il s’agit dorénavant de faire naitre un libéralisme éclairé prenant en considération la notion de solidarité au sein de l’espèce humaine. Sans oublier la justice, l’un des tous premiers concepts inventés par l’homo sapiens sapiens. Les États responsables de la préparation de l’avenir sont devenus des États du palliatif dispensateurs de protection et de consolation. Partout l’injustice est dénoncée mais elle persiste sous de multiples visages comme celui, honteux, du chômage.
C’est sur ces plans qu’il convient désormais d’agir pour mettre de l’ordre dans notre image du monde et pour que le libéralisme, remarquable facteur de développement, reste un moyen et ne se transforme pas en une religion sans garde-fous.
Le siècle des Lumières prétendait émanciper l’homme du despotisme et des préjugés. Les temps modernes ont enfanté un capitalisme généralisé à l’ensemble de la planète, un libéralisme appliqué presque partout sans bénéficier du respect général. Pour beaucoup ce capitalisme use et corrompt et crée ainsi les germes de sa destruction, d’ailleurs peu probable tant il a triomphé de multiples cancers. La culture-monde est loin de déboucher sur un consensus dans ce domaine. Car la réflexion économique a pris son autonomie par rapport à la morale. La crise récente a braqué les projecteurs sur ce divorce. Faute du principe d’équité et de responsabilité socio-économique, les marchés se sont financiarisés et l’appât du gain a succédé au « doux commerce ». De la Grèce antique à l’Europe du Moyen-âge l’analyse économique était une branche de la morale et de la théologie. Et pour Adam Smith, l’un des pères fondateurs de la science économique, l’économie qu’il analysait dans « La richesse des nations » n’était pleinement efficace dans la production et la distribution de richesses, dans une société et un Etat bien gouverné, que si elle reposait sur un socle moral solide et généralisé, décrit dans « Theory of Moral Sentiments ». Les phases d’essor de l’économie marchande ont conduit l’économie à devenir politique en raison de son rôle majeur dans l’évolution des sociétés. Depuis quelques décennies et surtout quelques années l’appât du gain a transformé de nombreux nouveaux « maîtres du monde » en spéculateurs sans garde-fous : l’homo economicus est en train de devenir surtout un financier davantage qu’un marchand ou un consommateur.
Le libéralisme s’est adossé, il y a longtemps, à des valeurs incontestables : l’honnêteté, le respect des autres et de la parole donnée, le travail et le bel ouvrage, la transmission du savoir… Dans nos sociétés modernes, ces valeurs sont devenues presque dérisoires.
Le capitalisme égalitaire, c’est un bateau sans voile, sans moteur et sans timonier mais la gestion actuelle des gains financiers, des salaires, bonus, retraites garanties des managers commence à donner une image dégénérée du capitalisme. Comment demander des sacrifices à ceux qui ne partagent pas équitablement les résultats d’une entreprise. Un tel système mine les institutions sociales qui le protègent et bloque tout espoir de consensus. D’où la nécessité d’une nouvelle sagesse prenant en compte une responsabilité intergénérationnelle, l’aspiration à une société plus juste et la notion du bien commun. Dans ce domaine la sphère économique ne se distingue pas des autres sphères de la vie sociale.
Il ne sert à rien de danser la danse du scalp devant le libéralisme et de le vouer aux gémonies, il faut simplement le doter d’un code moral qui le rende acceptable à la majorité. Qui recrée un peu de vertu et de grâce dans le système en déclinant l’immense désir de justice et de dignité de l’homme du XXIème siècle. Confucius notait que ne pas agir quand la justice commande c’est de la lâcheté. Le juste est la seule règle du confucéen dans les affaires du monde. Confucius, toujours lui, avait défini de la façon suivante le principe qui pourrait servir de guide universel pour toutes les actions de la vie : « Ne jamais faire aux autres ce qu’on n’aimerait pas qu’ils nous fassent ».
La partie du monde qui fait le tour du supermarché aux cent mille produits, du « tout, tout de suite », de la jouissance immédiate, serait bien inspirée de mettre en place un capitalisme moins gaspilleur de ressources rares et de génie créateur, d’anticiper un peu sur le mouvement en faisant rattraper la science par le politique. Comme la démocratie, le libéralisme est le moins mauvais des systèmes mais il est loin d’être parfait surtout quand ses pratiques sont poussées à leurs limites. La frilosité des politiques qui se contentent de gérer l’histoire telle qu’elle existe est dérisoire. Quand « les ruines menacent de recouvrir les espérances », il est temps d’agir.
Par un gigantesque effort d’éducation, principale source de valeurs dans l’évolution du monde. Et ceci au moment où dans de nombreux pays les dépenses d’éducation baissent en proportion du produit intérieur brut tandis qu’une crise des vocations liée aux bas salaires et au standing social insuffisant des enseignants risque de conduire à un désamorçage des systèmes d’enseignement à la base.
Par la satisfaction d’une revendication de justice et d’éthique qui déborde des croyances religieuses. Car pour beaucoup, qui ne reprennent pas à leur compte la formule attribuée à Malraux « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas », un code moral peut se concevoir indépendamment de toute base religieuse. Pourtant dans la mesure où l’humanité a tout expérimenté depuis les quelques milliers d’années où l’homme a commencé à penser, un code éthique ne pourrait-il être bâti à partir des convergences et des domaines communs que l’on peut observer entre différentes religions comme le bouddhisme, l’indouisme, le judaïsme, le christianisme et l’islam ; et les grands principes que l’humanité a adoptés sans toutefois toujours les appliquer comme les droits de l’homme issus des révolutions américaine de 1776 et française de 1789.
La mondialisation s’est développée beaucoup plus rapidement que ses nécessaires régulations et l’apparition d’un code éthique au niveau mondial. C’est sur ces deux plans qu’il convient désormais d’agir pour mettre de l’ordre dans notre image du monde et ne plus lire l’économie comme une religion sans tables de la loi.
Côté régulation les organismes sont trop dispersés : l’ONU, l’OTAN et les États-Unis pour la gendarmerie du monde, la Banque Mondiale, le FMI, l’OMC, le G2, le G8, G73, … pour l’économie. Tous et toutes datent d’années récentes à l’exception de l’OMC, d’ailleurs imaginée dans les accords de Bretton Woods. Il apparaît évident que le monde ne pourra faire l’économie d’une organisation confédérale, débouchant sur un minimum de fédéralisme, lui permettant de mettre de l’ordre dans la guerre économique.
Certains adoptent l’économie comme une religion avec son Dieu, sa bible et son clergé. Quant à nous autres sécularisés, prenons la distance qui convient. Le propre d’une idéologie est de se transformer en une vérité qui ne doit pas être débattue ; l’économie est en train de devenir une telle idéologie. Elle a ses mythes, ses espoirs, ses croyances, ses druides, son ciel et sa terre. Les hommes s’aiment assez pour supporter d’être ensemble mais pas de devoir partager leurs biens. Comment modérer la passion de la concurrence avec un peu de cet amour du prochain ?
Telle est une des autres questions posées au libéralisme. Un monde sans croissance au sens actuel du terme est-il concevable ? Nous sommes une fois de plus plongés dans une crise du sens. Et nombreux sont ceux qui sont prêts à suivre le premier gourou venu ; actualisant ainsi la célèbre formule de Marx sur la religion, opium du peuple. La modernité serait-elle un don vénéneux ? Un pape dénonce : « La mondialisation de l’indifférence » car pour le « frêle athlète de la vie » seule la performance compte. Notre patrimoine génétique se réveille épisodiquement et nous fait donner dans la compassion ou l’humanitaire et invoquer la fraternité oubliée. Ainsi récupère-t-on par ces « orages émotionnels » la dimension biologique de la parenté entre les hommes.
Il y a une mondialisation idéale, celle où le progrès de chacun contribue au progrès de tous. Mais comme l’a écrit François Perroux, le progrès n’est pas une « fatalité heureuse » ; il dépend de la persévérance dans l’effort et le risque est grand que la jungle de l’inconnu n’entraîne un retour aux idées simples comme l’extrême nationalisme, le racisme ou l’intégrisme. Les chevaux de l’apocalypse ne sont jamais très loin. L’épuisement des ressources naturelles, la pollution, le réchauffement climatique développent de nouvelles inégalités et sont source de conflits brutaux.
Rêvons d’un dialogue entre Averroès, Maïmonide, Saint Thomas d’Aquin, Aristote et Confucius qui réanimerait l’entrelacs des révélations et de la raison. D’un pari de Pascal étendu à l’ensemble de l’irrationnel et du rationnel. La raison et la foi s’adossant, quoi de plus humain pour faire face à nos interrogations et pour parvenir à une nouvelle et puissante avancé de la spiritualité humaine.
Une sagesse pourrait s’en dégager, libre d’ailleurs de toute tutelle religieuse (chaque religion ajoutant de la valeurs aux autres) car résultant de la pluralité religieuse, surtout si l’on fait également appel à quelques prix Nobel de la paix, responsables d’ONG, grands scientifiques et philosophes connus pour leur qualité humaine (des entrepreneurs d’humanité) et quelques libres penseurs et fervents partisans des droits de l’homme.
Car nous sommes tous des enfants d’Abraham, de la raison, de la sagesse. L’islam n’est pas la solution, pas davantage que le seul christianisme ou le judaïsme. C’est leur somme à conjuguer avec le bouddhisme, l’indouisme et le respect de l’autre qui peut nous rapprocher du ciel ou du sens sans nous faire perdre le contact avec le sol à condition que nous abattions nos idoles sources d’égoïsme et d’intolérance pour ajouter à l’important chiffrable l’essentiel qui échappe aux chiffres. Il arrive que des idées déchirent la pensée comme « des poids trop lourds déchirent les muscles » et exaltent la loi morale qui se trouve en nous. Un code éthique élaboré par un cénacle composé de représentants des religions et complété on l’a vu par d’autres « entrepreneurs d’humanité », notamment agnostiques, consoliderait de jeunes démocraties un peu partout dans le monde, freinerait l’absentéisme du cœur qui accompagne souvent la concurrence sans frein. De nombreuses prémisses d’un tel code éthique des temps modernes existent. Le congrès mondial des imams et des rabbins, les Nations Unies, au travers de réunions initiées par Kofi Annan (Global Compact 1999), le parlement des religions du monde et l’OCDE ont chacun de leur côté exploré le champ général de l’éthique.
L’intérêt de la réunion suggérée ici de tous ces grands sages regroupant les forces vives de toutes les spiritualités serait de dire une Parole, la parole libératrice de dieux qui ne se combattent plus, chaque religion devant trouver son chemin vers ce fond commun et lutter contre son propre sectarisme.
Dans les grandes religions monothéistes, à des degrés divers, Dieu parle à l’homme qu’il souhaite pleinement responsable. Tout homme est jugé sur ses actes. Il appartient donc à l’homme de rassembler les étincelles divines et d’humaniser le monde. Dans « Les origines du christianisme ». Renan écrivait déjà : « La morale est entrée dans la religion ; la religion est devenue morale. L’essentiel, ce n’est plus le sacrifice matériel. C’est la disposition du cœur, c’est l’honnêteté de l’âme qui est le véritable culte (…) Le règne de la justice, oui, telle est bien la loi de ces anciens prophètes(…) ».
Il ne s’agit pas d’effectuer la synthèse entre économie et morale mais d’envisager une nouvelle façon d’appliquer la morale à l’économie afin de donner un nouveau souffle à notre système économique actuel ; de doter l’économie de marché d’un référentiel éthique, d’une « loi morale dans nos cœurs » dépassant le politique. Et ceci au travers d’une « convention » de personnalités mondiales débouchant sur une « charte éthique du libéralisme » donnant sa légitimité à un droit positif universel, suivi de sa très large diffusion multilingue et multimédia.
Justice
Dans cet esprit le premier concept qui vient à l’esprit est bien entendu celui de justice. Pascal a raison de rappeler que les gens n’obéissent aux lois que parce qu’ils les croient justes. Le mot justice désigne des exigences morales (refus de l’arbitraire, des inégalités, des disproportions) qui se situent au plus haut sur l’échelle de l’utilité sociale et qui sont même source d’une obligation suprême. Il n’est donc pas étonnant que l’homme la revendique dès sa petite enfance. « La justice définit la condition sociale comme la mort définit la condition humaine ».
Ce n’est pas forcément le rôle des politiques, des chefs d’entreprise et des économistes d’administrer la justice mais sa véritable liberté sous-jacente. Repose-t-elle sur un ensemble d’états (la bonne santé, un logement décent, la possibilité de se nourrir, de lire, d’écrire, d’accéder à un minimum d’éducation) sur lesquels la convention pourrait se pencher et fixer notamment au monde des collectivités de toutes natures quelques règles de comportements afin que chacun puisse mener une existence décente basée sur la liberté, l’égalité, la solidarité et la mutuelle interdépendance des êtres humains.
Dignité
Le second concept qui fonde la vie en société est celui de dignité humaine. Tout portrait de l’homme exprime une élévation, un souci de l’autre, un objectif de coexistence (« je veux que ta liberté soit »). La dignité humaine est l’une des rares notions (ce qui est du à l’être humain parce qu’il est humain) sur lesquelles il est possible à la plupart d’entre nous de se mettre d’accord au moins dans une certaine mesure. Deuxième question posée à la Convention : Comment cet absolu se décline-t-il dans le libéralisme ? Comment celui-ci peut-il éviter de déboucher sur l’humiliation, sur la transgression des droits de l’homme ? Comment démentir Einstein : « Si l’homme commence à penser avec son cœur, c’est un grand miracle. »
Fraternité
Dans de nombreuses religions, la fraternité est présentée comme le fondement du devoir de solidarité et de justice envers son prochain car la dimension biologique de la parenté entre les hommes ne peut être escamotée.
Ce concept impose de travailler aux biens communs nationaux et surtout mondiaux (énergie, eau, nature…) pour déjouer la malédiction du meurtre d’Abel par Caïn aux origines de l’humanité.
C’est la communauté de nature qu’il s’agit donc de décliner pour que « ton frère vive avec toi ».
Solidarité
Partout, de tout temps, les êtres humains se sont entraidés pour survivre. Pourtant la solidarité ne s’impose pas forcément comme un fait de nature mais relève d’une démarche personnelle. Mais l’humanité est devenue une seule et unique tribu. Il doit y avoir solidarité dans la croissance faute de quoi la société serait mutilée, incomplète, sans âme et solidarité à l’échelle mondiale pour penser « nous » plutôt que « je ». Comment décliner ce concept : en relevant nos nouveaux défis : combats contre la faim, la pauvreté, l’ignorance, la haine de l’étranger, les préjugés ; contre la misère et la violence qui détruisent souvent le tissu social des grandes villes. En diffusant sans doute par les systèmes d’enseignement un esprit nouveau fondé sur la considération et le respect de l’autre. Car la pauvreté est toujours là.
Travail des enfants
La cinquième question porte sur le devenir de l’espèce humaine, nos enfants. Encore aujourd’hui dans de nombreux endroits, l’enfant est traité comme un esclave incapable de se défendre des prédations dont il est l’objet ; son enfance lui est volée. Il est aveuglant que la solidarité intergénérationnelle nous commande de donner l’autonomie intellectuelle à nos enfants avant de les faire entrer dans un monde du travail souvent rude et brutal. Pouvons-nous appliquer partout, sans nuance, les règles qui régissent l’éducation dans les pays d’occident ? Nous refusons le travail des enfants chez nous. Pouvons-nous l’accepter ailleurs ? Peut-on accepter une formation première plus réduite à condition qu’elle se double très rapidement d’une formation permanente inscrite dans la durée et l’efficacité ? Peut-être avec une énorme prudence et dans le respect de cette autonomie intellectuelle à créer, fondement de la maturité de toutes les jeunesses. Notre avenir est dans une force de travail éduquée plutôt que bon marché.
Égalité des chances au départ
La sixième question porte sur l’égalité des chances au départ, condition de l’acceptation des hiérarchies et espoir de promotion pour soi et ses enfants. C’est un des plus puissants moteurs du comportement humain. On est souvent loin du compte dans le système libéral d’aujourd’hui où la promotion se fait essentiellement par modification des structures qui offrent davantage de postes à statut plus élevé et où la mobilité ascendante se réduit fortement pour parfois s’inverser à l’occasion des crises économiques et de leurs prolongements. L’économie du numérique bouleversera- t-elle un schéma aussi figé en jouant le rôle d’un catalyseur de liberté ?
Égalité hommes femmes
La septième question concerne l’égalité homme/femme et sa traduction dans le monde du travail. Il est évident que dans de nombreuses fonctions la femme égalera l’homme et même le dépassera comme c’est déjà le cas dans plusieurs domaines. Nous avons jusqu’à une époque récente gaspillé la moitié des ressources de l’humanité ! Comment accélérer le mouvement, le rendre irréversible : par création d’une culture nouvelle dont on peut se demander pourquoi elle n’est pas arrivée à maturité plus tôt tant elle est, à tout point de vue, profitable ? Par des voies plus contraignantes (quota, surveillance et remplissage des viviers…) ? L’histoire est en marche dans ce domaine ; faut-il l’accélérer, la contraindre ? Et la seule parité quantitative ne suffit pas. Elle s’arrête trop souvent là où le pouvoir commence.
Pouvoir dans l’entreprise
La huitième question porte sur le pouvoir dans l’entreprise : sa concentration au sein d’un nombre restreint d’hommes constituant des castes plus ou moins fermées et souvent coupées de la base, de la masse des travailleurs, des ateliers de production ne va pas sans poser des problèmes tant la gestion de nombre d’entreprises est devenue complexe, anonyme, impersonnelle, éclatée, morcelée et tant il est difficile d’appréhender dans leur ensemble et dans leur variété toutes les questions qu’elle suscite. À l’échelon inférieur règne encore trop souvent le travail déshumanisant ; aux échelons intermédiaires une fraction du pouvoir se répartit entre des hommes qui n’ignorent pas qu’ils n’en auront jamais beaucoup plus et sont engagés dans des carrières sans relief, génératrices de frustrations; tandis qu’au sommet les « happy few » continuent à avoir le pouvoir de sacrifier tous les autres sur l’autel de la rentabilité. C’est ainsi que l’on pourrait résumer la façon dont certaines grandes entreprises prétendent encore aujourd’hui se gérer par l’utilisation d’un libéralisme basé sur une conception erronée de la liberté qu’il sous-tend. C’est beaucoup moins vrai, bien entendu, pour les P.M.E. On peut supposer que notre prédisposition au lien social justifie des modes de gestion moins rétrogrades. Là encore l’économie du numérique va bouleverser des schémas établis.
Question accessoire si l’on ose dire : Quel doit être le réel statut des personnes âgées et des handicapés dans l’entreprise ? Et comment éviter toutes les autres ségrégations de nature raciste, éthiques ; comment peut-on d’ailleurs imaginer que de telles discriminations ne sont pas une violation des droits de l’homme au détriment de la productivité car elles minent le soubassement social qui crée cohésion et motivation ?
Cupidité
Neuvième question : elle est posée par l’apparition de la cupidité dans le monde des rémunérations. Les inégalités de revenus et de fortune ont atteint des niveaux sans précédent depuis un siècle (au niveau mondial 8% de l’humanité reçoit 50% du revenu mondial et 1% en reçoit 15%) et vont à leur tour engendrer de fortes différenciations des modes de consommation.
La relative convergence des modes de vie des années qui ont suivi la seconde guerre mondiale se trouve ainsi interrompue, les nouveaux riches accédant à un mode de luxe spécifique et les autres vivants de plus en plus à crédit dans une société de l’image leur offrant des ersatz de produits de luxe. Une minorité de quelques petits pourcents de la population accapare désormais une part de plus en plus grande des revenus et des patrimoines. L’inégalité des fortunes accentue le phénomène car les fortunes croissent environ deux fois plus rapidement que les revenus. On reste dans l’entre soi. Pourtant Keynes écrivait déjà : « Nous pensons qu’on peut justifier par des raisons sociales et psychologiques de notables inégalités dans les revenus et les fortunes, mais non des disproportions aussi marquées qu’à l’heure actuelle. Il existe des activités humaines utiles qui pour porter leurs fruits exigent l’aiguillon du lucre et le cadre de la propriété privée… Mais pour stimuler ces activités il n’est pas nécessaire que la partie se joue à un taux aussi élevé qu’aujourd’hui. » Pour beaucoup il ne reste aujourd’hui que le plaisir, la jouissance illusoire du « tout, tout de suite » si bien exploité par les techniques marchandes contemporaines. D’une certaine façon notre société réduit l’esprit à la matière. On est loin du système hébreu de la remise périodique des dettes. « Pour quelques privilégiés gérer ou travailler dans une banque est plus profitable que la cambrioler. »
Sans oublier que tout ceci est parfaitement contraire aux règles de l’économie de marché telles que les a définies Adam Smith, toujours lui. Le marché, disait-il, ne peut jouer son rôle de « main invisible » que si chacun des acteurs modère son appétit et garde le souci du bien de la communauté à laquelle il appartient, formule d’ailleurs reprise sous une autre forme par Milton Friedman, le pape de l’école de Chicago, pourtant libéral à l’extrême. Comment modérer cet appétit de jouissance de ceux qui devraient défendre l’intérêt général.
« Chez l’homme en société, ce sont d’autres affaires ; il s’agit premièrement de pourvoir au nécessaire et puis au superflu ; ensuite viennent les délices et puis les immenses richesses, et puis des sujets et puis des esclaves ; il n’a pas un moment de relâche ; ce qu’il y a de plus singulier, c’est que moins les besoins sont naturels et pressants, plus les passions augmentent et qui pis est, le pouvoir de les satisfaire ; de sorte qu’après de longues prospérités, après avoir englouti bien des trésors et désolé bien des hommes, mon Héros finira par tout égorger jusqu’à ce qu’il soit l’unique maître de l’Univers » écrivait déjà Rousseau.
Comment réduire l’ampleur de cette loterie phénoménale qui s’est mise en place (il y a un demi- siècle la grille des rémunérations allait de 1 à 15 dans le meilleur des cas : ridicule à l’âge des « golden boys » et autres « maîtres du monde » où ce ratio se situe entre 500 et 1 200). Faut-il ramener à des proportions raisonnables le rapport du décile des plus faibles rémunérations à celui des plus élevées et le suivre dans le temps ? Sans doute si le responsable suprême doit créer un dévouement collectif autours de sa gestion. Y a-t-il un juste ratio entre les enrichissements résultats d’innovations qui ont fait progresser l’humanité et les autres rémunérations ? Pour les uns, il suffit de taxer beaucoup plus les revenus élevés et les grandes fortunes, ce qui poussera à toujours plus d’évasion fiscale ; pour d’autres (Warren Buffet, Bill Gates…) il est indispensable de développer une culture du mécénat à beaucoup plus grande échelle : ceux qui ont beaucoup reçu doivent beaucoup donner. On y reviendra.
La répartition des avantages ne doit-elle pas être telle qu’elle entraîne la coopération volontaire de chaque participant, y compris les moins favorisés, à une œuvre commune ? La très grande réalité du problème n’est-elle pas attestée par les hommes de la bible puisque les évêques s’émeuvent désormais des faramineux bonus accordés aux patrons, traders et autres financiers ? Et n’est-ce pas tant le cheminement et la démarche engagée qui importent, que le résultat. À tout le moins peut-on imaginer que chaque entreprise se dote désormais d’une structure (réel et indépendant comité d’éthique, …) lui permettant de commencer à réguler ce domaine ?
Philanthropie
Dixième question : La philanthropie ne doit-elle pas faire partie du « bien agir » comme disait Aristote ? À ceux qui ont beaucoup reçu n’est-il pas légitime de demander beaucoup ? Les religieux du livre le préconisent Certains objecteront que la charité n’a jamais fait disparaître la misère. Elle reste une action qui avec son originalité s’ajoute à d’autres pour en réduire les effets. Elle peut être aussi une façon de créer du terreau pour le créatif, le bénévolat, l’hybridation, le métissage culturel : partout dans le monde, le système associatif joue un rôle rapidement et spectaculairement croissant dans les relations humaines. À condition d’éviter l’écueil d’une éthique conçue comme un glaçage superficiel. Si Camus a raison de dire que nous n’aimons pas l’idée d’être responsable du malheur des autres, la philanthropie est-elle une façon de nous dédouaner de nos responsabilités ?
Corruption
La prévarication, la corruption, l’évasion fiscale font souffler un vent de colère et de braise à travers la planète qui doit obliger les politiques à prendre leurs responsabilités tant nos mœurs économiques sont, dans ce domaine, en pleine déficience. Quant aux institutions, à force d’être méprisées, elles prennent le risque de devenir méprisables. Et il existe un écart abyssal entre leurs déclarations et la vie des affaires telle qu’elle est pratiquée par certains, souvent haut- placés, dont les médias rapportent quotidiennement les méfaits.
Comment faire en sorte que le monde capitaliste ne fasse pas une telle place au malin ? Comment corriger l’image dégradée du libéralisme que projettent de tels comportements, telle est la question posée par cette néfaste évolution du libéralisme.
Biens marchands et non marchands
« Tout est commerce » avait dit dans un raccourci lapidaire le président de Sony. Tout est conflit, aurait-il pu ajouter, lui qui faisait trembler quotidiennement Philips, Thomson et quelques autres.
Tout est aussi excès, comme en témoignera un projet de construction d’un centre commercial près de l’ancien camp de concentration nazi de Ravensbrück. L’idéologie « molle » du libéralisme encourage les turbulences liées à la compétition industrielle internationale. L’histoire a pris le virage instable de la guerre économique.
La liste est longue des problèmes soulevés par l’exacerbation de la compétition internationale. Conflits sociaux, terrorisme, krachs boursiers, toxicomanie, délinquance sont autant de signes du manque d’équilibre de la planète et de la vulnérabilité de nos sociétés technicisées.
Du côté de la nature, la capacité dévastatrice des activités humaines a changé d’échelle. Les civilisations anciennes n’avaient fait qu’effleurer la surface de la planète. Désormais, la terre est soumise à des tensions qui dépassent ses limites d’autorégulations. Tout ce passe comme si nous constations que la portion d’univers qui nous est accessible est une prison. L’air et l’eau vont devenir des denrées rares. Les brésiliens, dans l’immense forêt amazonienne participe à la fourniture d’un air respirable, et les esquimaux, qui ont sous leurs pieds de gigantesques réserves d’eau douce, pourraient un jour présenter une facture au reste du monde. Ne payons nous pas aux pays pétroliers une rente sur le pétrole extrait de leur sous-sols ? Pourquoi les propriétaires de la forêt amazonienne et du Groenland ne recevraient t’ils pas à terme une dime sur le rôle de leur foret et de leur banquise ? A quand l’échange dette-nature par lequel les pays endettés s’engageront en échange de l’annulation de leurs dettes envers l’étranger à financer un programme de protection de la nature ?
Quant à la pollution, un prix unique du polluant allégerait le coût des politiques économiques.
Mais peut-on pour autant donner un coût à tout ce qui se relie intimement à la vie humaine ; à l’eau, à l’air, aux dons d’organes, au ventre des femmes et à la gestation pour autrui, à la vie ..? Les gens et plus généralement le vivant peuvent-ils être monnayés et brevetés ?
Pour avancer il faudrait identifier en profondeur les ressorts du comportement et de la moralité. Nos seuls sentiments de répulsion sont peu fiables comme source d’inspiration éthique. La vie, comme on sait n’a pas de valeur. Mais nos partis-pris dans les arbitrages liés à la santé s’inspirent pourtant indirectement et directement de valorisations non avouables. Et pour tout simplifier, une contribution payée (pour du sang, pour un rein,…) peut être interprétée comme un signe de cupidité, une volonté de paraître plutôt que comme une vraie générosité.
Alors où et comment desserrer les verrous ? Comment définir les biens publics et les traiter vertueusement ?
Société et éthique et vocation de l’entreprise
Treizième question posée aux membres de la Convention : le retour sur le devant de la scène du travailleur pauvre, du chômeur enfermé dans sa solitude, du déclassement et la précarisation des relations du travail ne méritent-elles pas un éclairage particulier débouchant sur un rôle élargi de l’entreprise ? Dans les époques de croissance soutenue le problème ne se pose pas ; tel n’est malheureusement plus le cas, nulle part dans le monde. Le moment n’est-il pas venu de réanimer ou plutôt d’ouvrir un débat sur la vocation de l’entreprise ? Elle est bien entendu de faire du profit et de le comparer à celui des autres mais on peut ajouter à cette obligation première un principe qui donnerait du sens au rôle des gestionnaires, celui de la préservation de leur potentiel humain. Ainsi pourrait-on éviter que les salaires soient de façon permanente la seule variable d’ajustement économique en cas de difficulté. Si ce principe se généralisait pour éviter toute distorsion de concurrence, cela pourrait conduire à une nouvelle approche des relations dans l’entreprise. Pourrait-on s’engager dans cette voie et sous quelle forme ? La création d’un passeport social pour chaque salarié permettant à celui-ci formation et reformation permanentes, moyens importants apportés aux systèmes de reconversion et de changement d’emploi, de préservation de la santé, toutes ces idées qui germent actuellement dans l’esprit de sociologues de l’entreprise ne sont-elles pas à encourager ? Notre patrimoine génétique a été, pour partie, conçu dans un certain environnement lorsque nous étions des chasseurs et des cueilleurs. Notre patrimoine actuel ne peut-il utiliser ces fondements pour améliorer notre vivre ensemble, pour aller vers l’inclusion plutôt que vers l’exclusion. Le degré le plus élevé de la charité n’est-il pas de permettre à un exclu de devenir autonome ?
L’entreprise est une structure très particulière qui sort timidement du principe de la maximisation comptable des gains. Dotée d’une considérable puissance d’agir, l’exigence sociale et maintenant éthique qui lui sont progressivement imposées par la société civile tendent à lui conférer un statut exorbitant. Car son profit comptable néglige de nombreux coûts économiques et sociaux dont elle ne paye parfois qu’une part infime. Pour certains économistes liberté du marché et équilibre social devraient être étroitement liés. Pour d’autres, plus révolutionnaires, des actionnaires seulement guidés par un souci moral ne devraient plus recevoir de dividendes. En réalité l’entreprise actuelle n’est n’y morale ni amorale. Sa vocation est de rémunérer le capital qui lui a permis de naître et de se développer. Mais on peut lui imposer d’autre contrainte à conditions que nombreuses et même majoritaires soient celles qui auront réussi à conjuguer rentabilité Stricto Sensu et responsabilité sociétale. Ce qui incidemment la rendra plus influente parce que plus intiment mêlée à la collectivité dans laquelle elle est insérée. D’où le danger également de faire du marché une religion et de la morale un répulsif. Jusqu’où doit aller cette exigence de responsabilité d’un capitalisme devenant « vertueux »? En allant jusqu’à rompre la primauté du capital sur l’homme. Peut-on jouer uniquement sur la réputation éthique de la société. C’est un seuil qui devrait pouvoir être franchi par le plus grand nombre et que de nombreuses agences de notation prennent désormais en compte. Car on peut semer le chemin des entreprises de contributions à l’équilibre environnemental et social à condition d’être sûr que la très grande majorité d’entre elles continuera à progresser. En cela le système libéral fondé sur la plasticité et la capacité d’adaptation d’un très grand nombre d’unités offre infiniment plus de souplesse que les systèmes où la stratégie des entreprises consiste à exécuter des instructions venues de l’extérieur. Le marché doit devenir un moyen au service de l’homme à l’écart d’un catéchisme de bonnes intentions et d’un système d’une complexité inouï. A tout le moins certains souhaiteront que le conflit entre travail et capital soit surmonté par le placement du travail à un rang amélioré par rapport au capital. Et qu’on explore un statut de « société à missions »
Il reste que le système actuel évolue entre des bornes dont on devine la position et qu’un code éthique du libéralisme ne pourra s’en désintéresser tant son évolution façonnera le monde de demain. Si le cœur humain goûte les idées de bien et de perfection dont il s’éloigne dans la pratique, les entreprises ne pourraient-elles fréquenter davantage, pour s’en imprégner, les mêmes concepts ?
La pauvreté
Pitié pour les statisticiens car on peut faire dire beaucoup de chose aux chiffres. Pendant les 13 première années du 21ème siècle, la mortalité infantile a chuté de 30% ce qui a permis de sauver trois millions de vies d’enfants. Mais le monde d’aujourd’hui n’est pourtant pas un monde idéal : ils sont 1,5 milliards à vivre avec moins d’1,25 dollar par jour. 2,5 autres milliards vivent avec moins de 2 dollars par jour. L’espérance de vie des femmes dans les pays africains est de moins de 45 ans tandis que mille d’entre elles meurent tous les jours pendant un accouchement. Pourtant le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté est passé en 40 ans de plus de 2 milliards à un peu moins d’un milliard, un résultat encourageant compte tenu de l’accroissement de la population mondiale et du ralentissement de la croissance depuis 2008. Cette évolution à un coût. En raison de la délocalisation des usines, quand la mondialisation bénéficie aux pays pauvres elle nuit à la « lower class » des pays riches. C’est acceptable globalement sur le plan éthique, pas pour les chômeurs en occident.
Quant à celui qui subit comme salarié les contraintes de la productivité, l’insécurité de l’emploi et recherche comme consommateur les produits importés à bas prix il ne scrute pas encore forcément ces contradictions qui sont celles d’un capitalisme poussé aux limites de la planète. Une éthique du libéralisme, elle, ne peut pas ne pas suggérer quelques règles du jeu mettant un peu d’ordre dans la compétition économique mondiale, qualifiée a juste de titre de « guerre économique » par certain.
Environnement, Écologie et Climat
Bien entendu tous ces thèmes se relient peu ou prou aux mesures en théorie impressionnantes prises très récemment (Cop 21) pour lutter sur le premier et le plus important des maux que notre planète s’est infligée, le réchauffement climatique.
Il n’est guère besoin de s’interroger sur le rapport profond existant entre écologie et éthique. Un modèle économique fondé sur la croissance évaluée à travers le PIB sans prendre en compte les dommages infligés à l’environnement et donc aux ressources vitales des générations futures ne peut se revendiquer de quelque code moral que ce soit. Nombre d’acteurs n’ont d’ailleurs pas attendu les travaux de la Cop 21 pour multiplier les initiatives visant à répondre aux défis du changement climatique.
L’agir humain ne peut qu’explorer prioritairement et ardemment, à partir de plusieurs portes d’entrée et d’un immense effort scientifique la transition énergétique seule capable d’épargner à notre planète les convulsions qui la menacent. Ainsi commencerons-nous à cicatriser les déchirures causées à notre planète par deux siècles d’industrialisation à marche forcée.
Ne faut-il pas faire violence à la violence ? L’histoire de l’humanité c’est peut-on espérer d’en finir un jour avec la violence de l’humanité. En revenant aux fondamentaux qui ont pour noms : l’homme, ses origines, son destin et la dérisoire précarité de sa traversée. Un capitalisme tempéré ne peut-il adoucir la guerre économique dans laquelle le monde est plongé depuis un demi-siècle ? Car au-delà d’un certain seuil la concurrence devient passion et s’exacerbe en volonté de puissance.
Il y a une mondialisation idéale celle où chacun contribue au progrès de tous. Mais l’histoire peut aussi induire des peurs génératrices d’attitudes belliqueuses. C’est la mondialisation détestable des raisins de la colère dévastant les sociétés les plus structurées et les plus cultivées.
Comment chercher la réconciliation, ne pas s’emprisonner dans le désir de vengeance ?
Bien entendu d’autres questions mériteraient des débuts de réponse ou de méthode s’agissant des enrichissements sans cause, de la prévarication, de la corruption et bien entendu de la nécessité de préserver la planète merveilleuse et fragile qui nous héberge, de la création de solidarité dans les immenses mégapoles où la misère et la violence détruisent le tissu social. Nous sommes la première génération qui a les ressources, les moyens, les technologies, les sciences pour résoudre la plupart de nos problèmes et impulser une dymanique de création collective. Ce qui veut dire qu’elle a davantage de responsabilités que celle de nos parents et de nos aïeux. Surtout si l’on se souvient que quatre milliards d’individus vivent avec un revenu inférieur à deux dollars par jour et que dans de nombreux pays l’espérance de vie est inférieure à 40 ans. On peut dans ces conditions être moraliste et même un peu moralisateur, sans que le mot tue…
En réalité une société libérale ne saurait s’identifier à une société laxiste, affairiste, … Dès que les préceptes issus de l’expérience des siècles passés ne sont plus observés les sociétés entrent inévitablement en décadence. La décadence est « une vacance des idéaux ».
Y a-t-il un équilibre possible entre liberté et responsabilité, propriété et équité, jouissance et limitation, science et morale, rationnel et affectif… Une certitude en tout cas : de cette coopération des contraires pourrait naître un tout éthique unificateur ! « C’est un malheur du temps que les fous guident les aveugles. », écrivait Shakespeare dans Le Roi Lear ; sommes- nous en position d’aveugles guidés par des dirigeants fous? Certainement pas pour la majorité d’entre eux. Ils font de leur mieux et l’apparition d’un code éthique du libéralisme « sur le bien agir » leur apporterait une colonne vertébrale morale bienvenue et vaudrait programme. Mais dans la seule et unique tribu que devient l’humanité c’est surtout par capillarité, métissage culturel et vertu de l’exemple qu’un tel référentiel éthique enseigné partout dans les écoles et dans les premières années de toutes les disciplines doit faire sentir ses effets car on oublie trop souvent que derrière les objectifs économiques et financiers des entreprises il y a des êtres humains avec leurs ambitions, leurs rêves, leurs problèmes et leurs emprunts à d’autres cultures. La liberté et la responsabilité d’un homme qui ne serait pas réduit, dégradé à la seule fonction économique y trouveraient motif à s’exercer pleinement. L’homme dont « un instant de vie contient 3 000 possibilités » deviendrait pleinement artisan de sa vie. Le libéralisme ainsi tempéré y gagnerait ses lettres de noblesse. L’essentiel est la fabrication de l’Histoire pas des richesses matérielles.






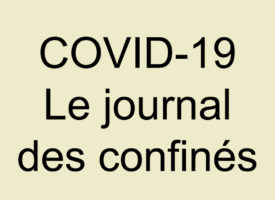
Aucun commentaire !
Soyez le premier à commenter cet article.